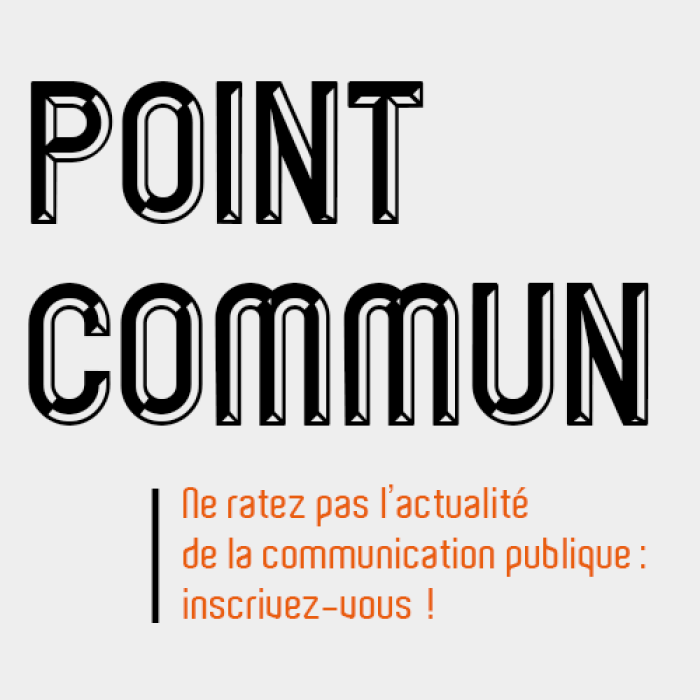« On ne peut pas réfléchir au futur de l'information sans réfléchir au futur de la société »
François Quinton, rédacteur en chef de « La Revue des médias » de l'Ina, présidera le jury du 27e Prix de la presse et de l'information territoriales. Méthodologie et transparence sont ses mots d'ordre pour analyser le passé, détecter les tendances fortes et se projeter dans l'avenir. Avant de tourner les pages des meilleures publications des collectivités de l'année, il partage avec nous son expertise fine des médias et de l'évolution du monde de l'information.
François Quinton est journaliste, rédacteur en chef de La Revue des médias, site de référence d’analyse des médias édité par l’Ina. Il est l’un des coauteurs du rapport de prospective « Le monde de l’information en 2050 : des scénarios possibles », piloté par l’Ina dans le cadre des États généraux de l’information (dont nous parlons au cours de notre entretien).
Il a précédemment dirigé Ina Global, la revue des industries créatives et des médias, après avoir été rédacteur en chef adjoint du site de critique de livres et de débat d’idées « nonfiction.fr ».

Point commun : Vous travaillez pour l'Institut national de l'audiovisuel en tant qu'analyste des médias au quotidien. Pourquoi avez-vous accepté ce rôle de président de jury consacré à la presse territoriale ?
François Quinton : On connaît tous l’Ina à travers les archives, en noir et blanc ou en couleur, diffusées hier à la télévision et aujourd’hui sur les réseaux sociaux (FB, Youtube, Instagram, Tiktok…). La mission de conservation et de valorisation des archives des médias audiovisuels est centrale, mais ne résume pas l’Institut, qui compte bien d’autres activités (production, formation, recherche, édition,…). Tout cela fonde l’expertise de l’Ina en matière d'observation et d'analyse des médias, dont La Revue des médias est une incarnation.
La presse territoriale est confrontée à des enjeux qui rejoignent en partie ceux des médias classiques : enjeux de proximité, de service, de confiance, de sentiment d'appartenance et de liens partagés au quotidien à l'échelle locale.
Les enjeux de la presse : la proximité, le service, la confiance, le sentiment d’appartenance.
Présider le Prix de la presse et de l’information territoriales, c'est avoir la chance d'observer attentivement la manière dont la presse territoriale se saisit de ces enjeux et leur donne une forme éditoriale. La presse territoriale peut jouer un rôle complémentaire à celui de la presse locale, qui traverse, comme l'ensemble de la presse, une situation difficile.
Le 27e Prix de la presse et de l’information territoriales
Près de 80 dossiers ont été reçus cette année. Le Prix de la presse et de l'information territoriales 2025 sera remis par François Quinton le vendredi 13 juin prochain, à l'occasion d'une cérémonie en ligne retransmise en direct. Inscrivez-vous gratuitement !
Point commun : Quel est le rapport de l'Ina aux services publics et plus particulièrement aux territoires ?
François Quinton : De par son statut d'Epic (établissement public à caractère industriel et commercial) et ses missions – notamment celle de conserver et de valoriser les archives audiovisuelles et la mission du dépôt légal des médias audiovisuels et d’une partie du web français –, l'Ina remplit évidemment un rôle de service public. Qui plus est, en assumant pleinement, en tant que média patrimonial, son appartenance à la famille de l'audiovisuel public.
Le siège de l'Ina est à Bry-sur-Marne (94), à côté de Paris. L’Institut est également présent en région à travers six délégations régionales à Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Rennes et Strasbourg. Ces délégations relaient les activités et les services de l'Institut au niveau local et développent des partenariats ou des offres de services spécifiques. En complément, des centres de consultation des archives existent un peu partout en France métropolitaine et dans les Outre-mer. Ils sont essentiellement situés dans des bibliothèques ou des médiathèques.
Point commun : L'intelligence artificielle est un sujet omniprésent dans l'espace médiatique en ce moment. Quel est votre lien à l'IA ? Quel est son impact dans votre quotidien, autant pour vous, pour votre production, que pour la production que vous analysez ?
François Quinton : Tout récemment, à l’occasion du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle, l’Ina a piloté et coordonné la production de la première cartographie des enjeux de l'IA pour ceux qui produisent l'info, en partenariat avec les médias audiovisuels publics français. L'idée était d'expliquer et d'articuler l’ensemble des défis que l'IA pose aux médias d'information, depuis la collecte d'informations jusqu'à la diffusion et la réception.
En janvier, dans notre nouveau baromètre data.ina.fr, nous avons quantifié (grâce à l'IA, d'ailleurs) la place prise par l'IA dans les médias audiovisuels et mis en évidence un tournant : le lancement de ChatGPT le 30 novembre 2022. Depuis, les médias audiovisuels parlent sept fois plus de l'IA que précédemment. Il y a donc un changement en termes de ce que nous, auditeurs et spectateurs, pouvons voir et entendre. L’IA est devenu un sujet pour le grand public. L’IA a aussi permis de mesurer de façon précise le temps de parole des hommes et des femmes dans les médias audiovisuels.
Du côté de La Revue des médias, nous utilisons l'IA pour objectiver des phénomènes de médiatisation. Par exemple sur le traitement des violences sexistes et sexuelles dans les médias, sur le traitement du conflit russo-ukrainien, sur le conflit israélo-palestinien… L'IA nous est également utile de manière très concrète pour nous permettre d'accéder à des articles écrits dans des langues étrangères que nous ne parlons pas, ou pour nous aider à résumer un article de 3 000 mots en 300 mots, dans la perspective d’une déclinaison vidéo d’un article.
Dans ce cas précis, ce que donne l’IA est toujours une proposition, qui sera ensuite systématiquement vérifiée et retravaillée. De même, quand nous utilisons des outils d'IA pour observer des phénomènes médiatiques, les résultats sont vérifiés, et notre méthodologie est transparente. C'est essentiel pour asseoir la crédibilité de ce qu'on diffuse. Nos outils sont robustes, c'est important de communiquer là-dessus. Et, même s'il y a toujours des biais, quelles que soient les façons de procéder, il est important d'en avoir conscience et d'être capable d'évaluer leurs effets et de mettre l'information à disposition.
Le rôle des médias d’information est de contribuer à un débat démocratique et partagé.
L'IA générative facilite la production et la diffusion de contenus synthétiques et du faux sur les réseaux sociaux. Mais les critiques sur le rôle de ces réseaux sociaux dans la polarisation du débat public, sous l'effet à la fois du phénomène de bulles de filtre et de la prime accordée par les algorithmes aux posts qui suscitent des émotions négatives, sont beaucoup plus anciennes. Il faut garder à l'esprit que le clivage, le dissensus est intrinsèque à la démocratie qui organise la sélection entre différentes options possibles. Encore faut-il que le débat repose sur des bases factuelles partagées. Et ça, c'est le rôle des médias d'information. La polarisation devient néfaste quand ces conditions ne sont plus réunies. C'est un défi majeur
Point commun : En quoi la presse territoriale se différencie-t-elle de tout cela ?
François Quinton : Je dirais que, par définition, la presse territoriale est une presse qui va chercher à rassembler, à organiser le consensus vis-à-vis d’une collectivité et de ses réalisations. C'est une différence majeure. Elle est peut-être aussi moins portée que d’autres sur la recherche de « buzz », et évidemment plus ancrée dans l’information de service au plus près des habitants..
Point commun : Au milieu de cette période plus qu'incertaine, et ce, sur tous les plans, comme nous l'évoquions, vous avez pris part à la rédaction du rapport de prospective « Le monde de l'information en 2050 : des scénarios possibles ». Comment avez-vous construit vos scénarios de prospection ?
François Quinton : Ce rapport est une commande des États généraux de l'information. L'objectif était d'essayer de projeter le regard au-delà de l’actualité et d'imaginer à quoi pourrait ressembler le monde de l'info en 2050. Pour ce rapport, nous avons beaucoup lu et auditionné 36 personnalités, qui ont chacune des expertises ou des regards qui nous semblaient intéressants. Nous avons ensuite construit une matrice pour projeter les effets des cinq grandes transformations (technologiques, politiques, sociétales, économiques, écologiques) qui conditionneront le paysage de l’info en 2050.
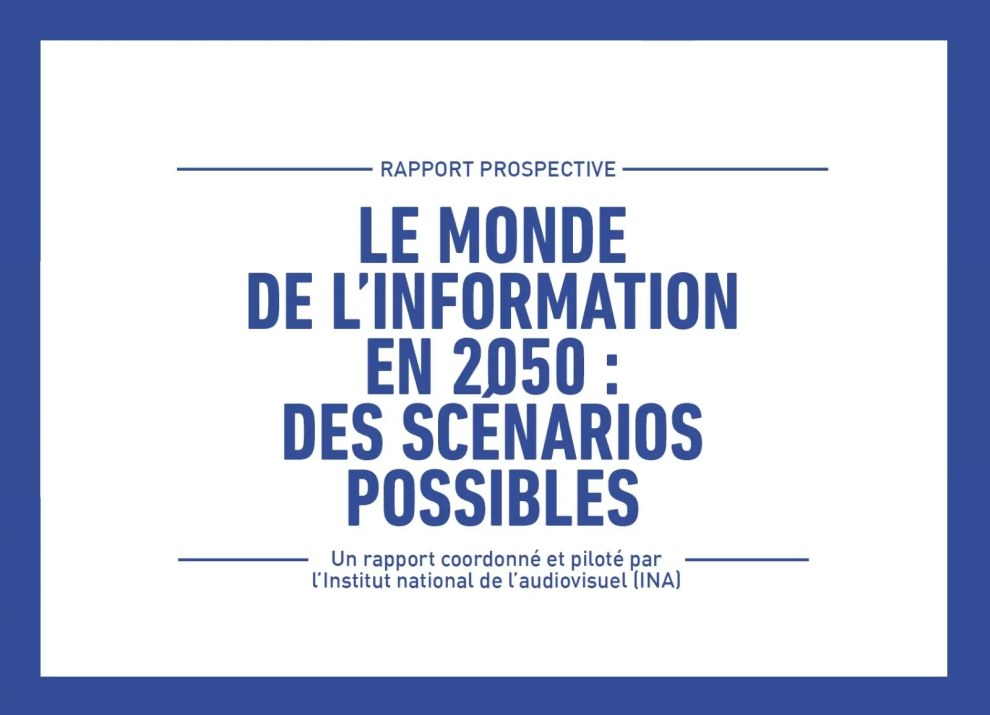
Nous en avons tiré trois scénarios : un scénario très optimiste, ou « clair », qui promet un âge d’or de l’information, un scénario très pessimiste, ou « obscur », qui envisage la mort de l’information, et un scénario médian, ou « clair-obscur ». Aucun ne se réalisera tel quel, mais ils permettent de mettre en évidence des enjeux structurels. Ce sont trois scénarios possibles parmi une infinité.
Nous avons mis la matrice à disposition dans le rapport, en précisant que chacun peut la compléter et s'amuser à relier les différents points comme il le souhaite pour bâtir ses propres scénarios et imaginer d’autres avenirs !
Point commun : Comment est-il donc possible de se projeter en 2050 ?
François Quinton : C’est très difficile de prévoir ce qui va se passer d'ici à 2050. D'ailleurs, si on se replaçait à peu près vingt-cinq ou vingt-six ans en arrière – soit le temps qui nous sépare de 2050 – on aurait eu beaucoup de mal à décrire le paysage actuel. Certes les chaînes d’information continue existaient mais pas les smartphones, ni Facebook, Youtube... Il y a eu des changements majeurs qui ont vraiment tout bouleversé. Et entre le moment où l'on a produit le rapport en septembre 2024 et aujourd'hui, Donald Trump a pris ses fonctions : en quelques semaines, beaucoup de choses ont changé pour les médias américains.
C'est pourquoi nous avons essayé d'identifier des facteurs qui nous paraissent plus importants que d'autres et qui vont conditionner notre avenir au-delà de l’information. Parce qu'on ne peut pas réfléchir au futur de l'information sans réfléchir au futur de la société.