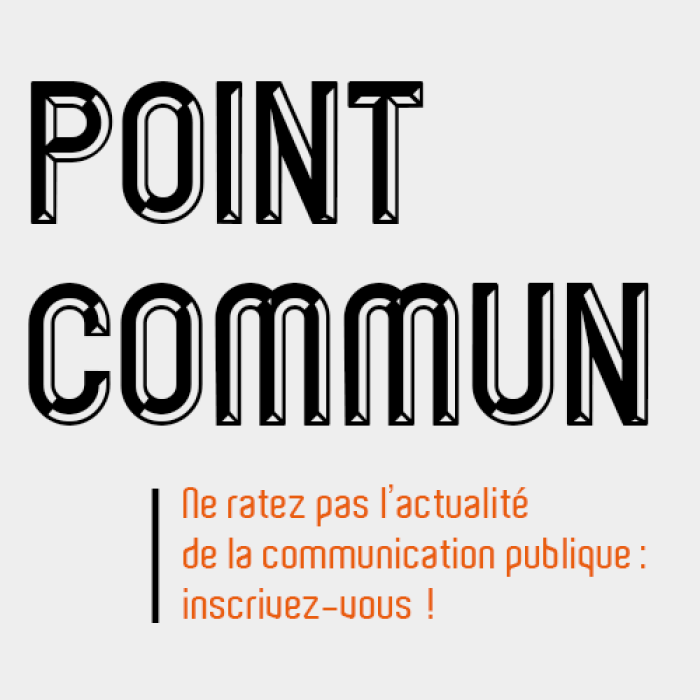Reconstruire la confiance : une thérapie par le dialogue dans un espace commun
Les crises passent et la mésentente reste, c’est un constat que l’on peut faire aujourd’hui plus qu’hier. Il y a à l’évidence des dépôts successifs d’incommunication, et un des défis de la communication publique est de rétablir le dialogue après une crise, en tenant compte de celles qui l’ont précédée.
Reconstruire la confiance, c’est avant tout reconstruire le lien social. Car vivre ensemble suppose de faire confiance à des personnes en dehors de son cercle familial ou proche. La confiance se gagne, mais surtout, elle se verbalise. C’est bien là une des lettres de noblesse de la communication : permettre de se comprendre, de se mettre d’accord sur des idées parfois abstraites, pour vivre ensemble. Toutes les crises sont des moments d’incommunication. Le retour du dialogue devient alors un signe fort de rétablissement de la confiance. Cela ne signifie pas que tout est oublié, mais que le lien est en voie de réparation.
Une société humaine est constituée d’usages, de codes, d’un référentiel collectif et même d’un langage, qui permettent de faire confiance à des voisins de territoire, dans un groupe large. Sans cela, nous resterions à l’échelle de groupes familiaux, celle où les relations sont suffisamment intimes pour que la confiance s’établisse naturellement. C’est d’ailleurs ce qui se passe au cœur de la crise, lorsque les repères se brouillent et que les réflexes de survie ramènent chacun vers les siens. Cela rend d’autant plus délicat le retour à une situation « normale » après la catastrophe.
Un trauma, mais aussi une mémoire commune
Il faut donc reconstruire le lien social, « faire société », mais pas en niant ce qui vient de se passer. C’est sans doute le point le plus important à approfondir avant d’envisager des actions concrètes pour rétablir la confiance. Une crise est avant tout un événement vécu collectivement, qui impacte différents groupes à des degrés divers :
- elle peut être circonscrite à un territoire et à sa population (les victimes d’une inondation par exemple) ;
- elle peut toucher des populations indirectement (les riverains des zones inondées, ceux qui connaissent des pénuries de ce fait ou les acteurs économiques ayant des intérêts sur la zone) ;
- enfin, elle peut avoir une portée plus large et frapper les esprits plus largement (les populations qui vivent dans d’autres zones inondables, les proches, les personnes solidaires, etc.).
Une émotion vécue collectivement crée un traumatisme commun, qui nous fait évoluer positivement ou négativement, et qui demeurera dans la mémoire de chacun. On peut même dire qu’une épreuve soude une population qui l’a affrontée. Cela devient un « patrimoine affectif » qui comprend le souvenir de solidarités, de liens, de soutiens et pas seulement de peurs, de blessures ou de trahisons. Restaurer la confiance, c’est donc accepter le sort et en garder ce qu’il y a de plus fort et de plus humain dans l’épreuve.
Ne pas revenir à la situation d’avant
Une crise nous transforme durablement, que ce soit individuellement ou collectivement. Et c’est peut-être la deuxième leçon à retenir : rien ne dit que ce changement doit être effacé. Reconstruire la confiance pour qu’une société soit à nouveau vivable ne veut pas dire reprendre là où nous en étions avant. Il y a des conséquences, et les responsabilités de la crise peuvent nécessiter que justice soit faite. La confiance repose sur la justice et l’équité, comme le soulignent plusieurs sociologues tels que Jean Viar ou Erwan Lecœur. Ces valeurs, profondément enracinées dans le collectif, trouvent leur ancrage dans un territoire et dans les relations qui s’y tissent.
Repartir du territoire
Une population, un espace, des règles communes et des institutions pour les garantir : lorsqu’une crise intervient, c’est bien la trame qui demeure. Et c’est ce qui fait la différence avec le monde des marques et des acteurs économiques, qui peuvent changer, voire disparaître pendant la crise et qui n’ont pas de comptes à rendre en matière d’égalité. Reconstruire la confiance est donc évidemment une affaire de parole publique, et, bien souvent, de parole publique locale.
Activer les relais, s’appuyer sur les communicants
Faire appel au collectif et renouer des liens de confiance avec les représentants du territoire, c’est reconstruire le tissu républicain depuis la base. Dans les pays et les régions où la tradition démocratique est ancienne et ancrée, cette colonne vertébrale reste un atout, même en temps de crise.
Reconstruire la confiance, c’est activer des relais parmi ceux qui ont des convictions, qui ont le sens du devoir, de l’intérêt collectif. Et il y en a beaucoup, de ces « réservistes de la République » : enseignants, responsables associatifs, soignants, pompiers volontaires et tant d’autres. Souvent déjà bénévoles, ils sont mobilisables pour servir de relais de confiance lorsque les discours ont perdu leur efficacité et que la crise a altéré le crédit des organisations (notons toutefois que la perte de respect, constatée unanimement, envers les enseignants est un signe alarmant en ce qui concerne ce point de vue). Les communicants publics sont à pied d’œuvre pour retisser ces liens en proximité, à l’échelle des collectivités locales. Ils connaissent les lieux et les gens, c’est leur métier et ils ont préparé le terrain, ce qui leur donne souvent un avantage lorsqu’il faut renouer le dialogue.
Une confiance si fragile
Reconstruire la confiance s’avère quelquefois impossible, soit parce que la confiance n’était pas là avant la crise – il s’agirait donc à ce moment-là de « construire » cette confiance – soit parce que le mensonge a été trop énorme. C’était le cas pour le nuage de Tchernobyl qui restera à jamais un exemple de mensonge d’État, qui plus est sur une question de santé publique, et qui a entraîné des répliques, comme avec l’épisode des masques manquant au début de la crise Covid.
Certains spécialistes voient là les ferments d’une profonde défiance qui perdure au-delà des crises.
Extrait d’une boîte à outils
Ce texte est la contribution du délégué général de Cap’Com à La Boîte à outils de la communication de crise, ouvrage de Natalie Maroun qui vient de sortir aux éditions Dunod (voir notre chronique Pages de com) et qui propose des fiches opérationnelles au quotidien, des graphiques pour visualiser l’essentiel, des cas pratiques et des avis d’experts.
Crédit photo : © Stocklib / Jose Maria Hernandez.