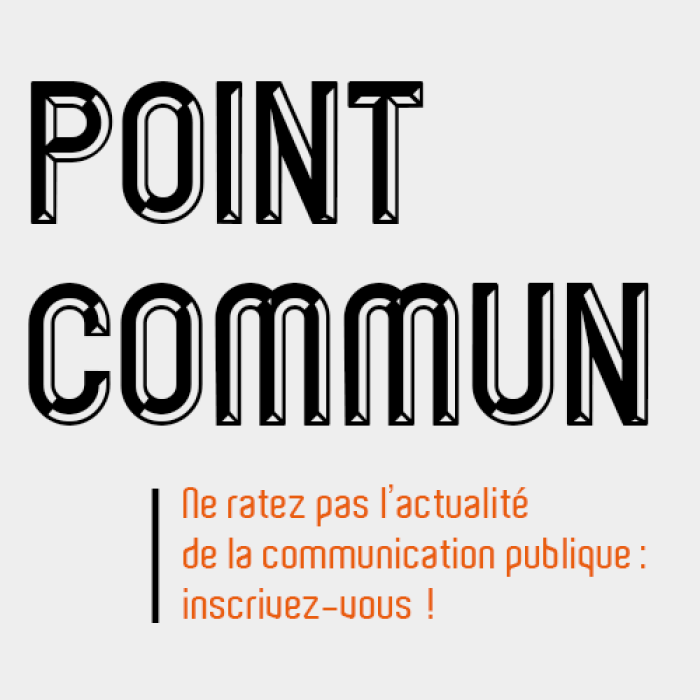« L’open data nous permet de mieux répondre aux principes du service public »
En marge du 6e congrès national des élus au numérique des 6 et 7 février, l’expert en open data Samuel Goëta a répondu à nos questions pour expliquer que l’accès public à la donnée peut renforcer les collectivités et leur relation aux citoyens. Dans une période où l’on parle plus volontiers de guerre de l’information, de rapport de force autour de la gestion des données, il défend des principes de transparence et de partage qui, finalement, profitent au collectif et permettent à d’autres services d’émerger. L’open data, c’est l’occasion, y compris pour les communicants, d’aller au plus près des habitants en passant par les données fines, désormais disponibles.
Sociologue, expert et militant de l'open data, Samuel Goëta est cofondateur de la société coopérative Datactivist où il accompagne des projets d'ouverture de données : « On accompagne les acteurs publics sur leur stratégie data, IA, avec un fort prisme open, open data. On travaille aussi sur les questions d'ouverture des données de la recherche, même d'ouverture des publications. Donc on a dans notre ADN la défense de l'ouverture au sens large de l’accès aux données et en particulier l'innovation. »
Il a également cofondé l'association Open Knowledge France en 2012 qui anime notamment le site madada.fr, facilitant l'usage citoyen du droit d'accès aux documents administratifs.
Samuel Goëta est maître de conférences associé à Sciences Po Aix. Ses recherches portent sur les politiques d'open data, la transparence par les données et la data literacy. Il est également ancien communicant car il a travaillé pendant deux ans dans l'agence de communication la Netsquad.
Point commun : Vous intervenez au 6e congrès des élus du numérique. Quel est le thème de votre intervention ? Qu’attend-on de vous ici ?
Samuel Goëta : J’interviens sur le lien entre les données et le service public, tout simplement, et en particulier avec les données ouvertes. Je commencerai par expliquer que cela concerne au premier chef les collectivités, que ce soit pour la gestion des ressources, pour l'optimisation des flux, ou même pour observer, connaître le territoire et donc différents cas d'usages. Et je vais insister sur le fait que le service public se transforme avec les données, mais que les données transforment aussi le service public. On est dans une co-construction et ça permet de faire émerger de nouvelles formes de gouvernement.
Au milieu de tout ça, l'open data s'inscrit comme un engagement fort, une action qui est demandée par la loi, mais qui a aussi beaucoup de sens pour les collectivités afin de leur permettre de répondre aux grands principes du service public, comme le principe de continuité. En fait, dès lors que les données sont ouvertes, tout le monde peut s'en saisir, sur la durée. Ensuite il y a un principe d'adaptabilité, de mutabilité, parce qu’avec cette ouverture des données, tout le monde peut créer de nouveaux services, mais on ne peut pas le prévoir. Je prendrai l’exemple de Papillon, une application qui a été faite en open source autour de Pronote et qui cartonne ! Elle est en tête de l'App Store. Ses créateurs, des lycéens, ont pris les données de Pronote pour en faire une interface, celle dont ils avaient envie. Enfin, le dernier principe, c'est évidemment l'égalité d’accès. Quand on voit que des collectivités font des accords avec Waze pour obtenir des données en échange de certaines autres données, le fait ensuite de les mettre en open data, c'est aussi une manière de ne pas favoriser ces acteurs en situation de monopole. Elles ont donc là les moyens d'obtenir les données et de faire émerger une concurrence tout en permettant quand même de bénéficier des services de ces géants du numérique sans entraver les autres qui pourraient émerger.
Point commun : Le sujet de votre intervention et ce que vous venez de nous expliquer ont à voir avec votre dernier livre Les Données de la démocratie.
Samuel Goëta : Oui, tout à fait, dans cet ouvrage sorti chez C&F Éditions en février 2024 (avec la préface d'Axelle Lemaire, l'ancienne secrétaire d'État au numérique), je défends l'idée que pour débattre on a besoin de données. Pendant très longtemps on s'est contentés d'informations qui étaient prémâchées, de chiffres agrégés à l'échelle du pays. Alors qu'en fait, pour avoir un débat de proximité, mais un débat qui entre aussi dans le détail des flux, on a besoin d'accéder aux données dans leur plus grand niveau de précision, de pouvoir entrer dans le détail des données.
Le fait d'accéder aux données est une exigence essentielle pour les habitants, les citoyens.
Et c'est ce que permet en fait le mouvement de l'open data : c'est-à-dire à la fois accéder à des données qui sont librement réutilisables, mais aussi entrer dans le détail, permettre des analyses qu'on n'avait pas imaginées et proposer d'autres formes de calculs, voire contester des décisions. Et, du coup, cela participe de l'édifice démocratique. Et on le voit sur certains sujets, comme l'égalité des chances à l’école, la crise énergétique ou le Covid. En fait, le fait d'accéder aux données est une exigence essentielle pour les habitants, les citoyens.
Point commun : Tout ce que vous venez de dire me rappelle fortement le dernier atlas IGN 2024 que nous avions chroniqué dans nos colonnes. Ils y ont répertorié les différents champs dans lesquels ce big data, cette manière de traiter les données, bouleverse complètement leur façon de travailler, avec, en plus, l’irruption de l’IA. Votre travail est bien aussi à cheval avec ce territoire, celui des géographes ?
Samuel Goëta : Un petit peu, effectivement. Là, en début de la conférence, j'ai montré un travail qu’a fait notamment le géographe Jacques Lévy qui, avec toute une équipe, a travaillé sur une masse de données téléphoniques pour montrer l'inadéquation qu'il peut y avoir, dans certains territoires, entre le transport, l'offre de transport et la réalité des déplacements. Cela démontre qu’il y a des transformations assez fortes du fait de la circulation des données, du fait de nouvelles techniques d'analyse, de visualisation.
Je pense qu'il y a de plus en plus un véritable appétit du public sur ces questions de données. Moi je le vois sur l’IA : j'hallucine de voir que, quand Lucie – l'IA française qui n'était pas finalisée (c’était un projet de recherche) – est sortie, ça a fait France Inter à 8 h 50, et que DeepSeek fait la une de tous les journaux. C’est quand même le signe qu'il se passe quelque chose et que derrière cela on peut ramener les gens vers les questions de données. Nous sommes sur ce projet-là.
On a des possibilités – en donnant accès aux données, en proposant des visualisations – d'entrer dans le détail, d'être dans une communication de proximité.
Point commun : Les communicants publics, à qui vous vous adressez, sont également intéressés par ces sujets. Vous, en tant qu’expert, qui êtes déjà intervenu auprès de Cap’Com, qu'est-ce que vous leur donneriez aujourd'hui comme conseil, comme point de vigilance ?
Samuel Goëta : Ce que je disais au début, qu'en fait, pendant très longtemps, on a communiqué au public une information qui était prémâchée alors qu’on a des possibilités – en donnant accès aux données, en proposant des visualisations – d'entrer dans le détail, d'être dans une communication de proximité. Et je pense que l'exigence est de plus en plus forte de ne pas se contenter de chiffres à l'échelle d'un territoire (qui peut être grand ou petit), mais d'aller au plus près des habitants. C'est ce que permettent les données. Quand on a une visualisation, on peut aller au plus proche, dans la rue. On voit cela par exemple sur les indices de position sociale des écoles, avec des précisions école par école, et cela permet d’alimenter le débat public.
Pouvoir dire que ce que l'on vous affirme, on vous donne en même temps accès aux données pour le vérifier.
Il y a un autre intérêt à cette précision des données, à ces techniques de visualisation et à l'open data, car – et c’est ce que j'ai dit il y a sept ans lors de vos Rencontres nationales du numérique – le fait de s'appuyer sur des données ouvertes dans la communication publique, cela donne plus de poids au message des communicants publics parce qu'on peut vérifier, étayer, mais aussi récuser, démentir ! Et donc c'est important dans une période de défiance de pouvoir dire que ce que l'on vous affirme, on vous donne en même temps accès aux données pour le vérifier. Il y a une exigence qui émerge, un peu comme dans les sciences, celle de reproductibilité des résultats, de vérifiabilité, je ne sais pas si le terme existe mais... on va l’inventer.
Un congrès pour des villes numériques responsables
Le congrès national, où nous avons réalisé cette interview, est un temps fort annuel dans l’agenda des élus au numérique, des maires et des agents, ouvert aux acteurs des territoires, citoyens et entreprises, organisé par l’association Villes Internet présidée par Mathieu Vidal, géographe à l’université de Toulouse, adjoint délégué au commerce, à l’artisanat, au tourisme, à la ville numérique, aux systèmes d’information de la ville d’Albi.
Pour cette édition 2025 à Saint-Raphaël, les thématiques choisies reflètent la vision large et très actuelle de cette association : la pédagogie du numérique, l’accessibilité, le numérique responsable, la sobriété, l’engagement au service de l’intérêt général, etc. On retrouve d’ailleurs ce souci d’inclure les questions du numérique public dans un écosystème citoyen en consultant leur Atlas des services publics numériques locaux, une somme très détaillée d’actions concrètes qui peut servir d’inspiration pour obtenir le précieux label Villes Internet (dont Cap’Com est partenaire), dont le palmarès 2025 et les collectivités labellisées ont été revélés à l'occasion du congrès.